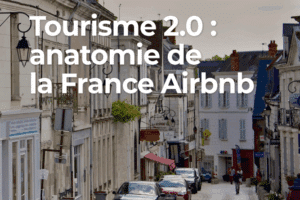Pour la première fois, une étude embrasse le harcèlement à l’école dans sa totalité : l’IFOP, Marion la main tendue et Head and Shoulders dévoilent une recherche inédite qui ne se limite pas aux seules victimes, mais analyse le phénomène dans toute sa complexité – harcelés, harceleurs, témoins – et révèle le continuum de violence qui les relie.
Reposant sur une enquête quantitative réalisée auprès d’un échantillon exceptionnel de 3 000 collégiens et lycéens – soit trois fois la taille habituellement retenue dans les enquêtes sur le sujet – cette étude s’inscrit dans la continuité d’une première recherche pionnière menée en 2023. Elle se double cette année d’un volet qualitatif innovant auprès de 80 parents d’enfants harcelés, mené à l’aide d’un agent conversationnel intelligent.
Cette approche globale et systémique permet de documenter les mécanismes invisibles du harcèlement : comment certains jeunes basculent du statut de victime à celui d’auteur, comment les témoins deviennent complices malgré eux, comment les familles vivent l’impuissance. En croisant les regards – victimes, auteurs, témoins, parents – l’étude révèle ce que les approches fragmentaires masquaient : le harcèlement comme système complexe où les rôles ne sont pas figés et où la violence se reproduit.
Le harcèlement scolaire est un phénomène de masse qui concerne un jeune sur cinq : selon cette nouvelle étude IFOP, 17% des collégiens et lycéens ont vécu un harcèlement au cours de leur scolarité, tandis que 7% reconnaissent en avoir été les auteurs. Ces indicateurs, obtenus à partir d’une mesure objective et stricte – l’exposition répétée à des violences verbales, physiques ou psychologiques pour les victimes, ou le fait d’avoir infligé de telles violences de façon répétée pour les auteurs – révèlent l’ampleur réelle d’un phénomène qui dépasse largement les seuls cas médiatisés.
L’étude déconstruit l’opposition simpliste entre « victimes » et « bourreaux » en révélant deux réalités : une majorité de harceleurs ont eux-mêmes été victimes, D’autre part, les profils sociodémographiques et psychologiques des harceleurs et des harcelés se superposent : timidité marquée, situation de handicap, redoublement, vie en internat. Ces convergences suggèrent que le harcèlement ne circule pas entre deux populations distinctes mais se propage au sein d’un même groupe fragilisé.
L’enquête établit également une corrélation forte avec la violence familial, qui fonctionne à la fois comme terreau et conséquence du harcèlement : les jeunes reproduisent à l’école ce qu’ils observent à la maison, tandis que le traumatisme du harcèlement déstabilise l’équilibre familial. Une chaîne de reproduction où la violence circule entre sphères et entre statuts, se nourrissant d’elle-même.
Le harcèlement comme phénomène de groupe
Le harcèlement est avant tout un phénomène de groupe, structuré par une dynamique complexe de domination et d’entraînement. 74% des victimes rapportent avoir été harcelées par plusieurs personnes à la fois, et 89% identifient la présence d’un meneur qui orchestre et légitime la violence. Ce meneur joue un rôle central : il désigne la cible, initie les premiers actes, et crée une permission sociale qui entraîne derrière lui des jeunes qui, pris individuellement, n’auraient peut-être jamais franchi le cap. Les données du côté des harceleurs confirment cette mécanique : 61% admettent qu’ils n’auraient pas agi seuls, 58% ont été encouragés par les rires ou l’approbation de leurs camarades, 54% ont harcelé par conformisme (« tout le monde le faisait »), et 46% par peur d’être eux-mêmes rejetés s’ils ne participaient pas. Le harcèlement fonctionne ainsi comme une violence défensive et mimétique : on agresse pour appartenir au groupe, pour ne pas devenir soi-même la prochaine cible. Le groupe trouve dans l’exclusion d’un bouc émissaire une cohésion négative, et plus il se soude autour de cette violence, plus il devient périlleux pour un témoin de s’y opposer sans risquer l’exclusion à son tour.
Les séquelles du harcèlement ne s’effacent pas une fois la violence terminée
L’étude révèle que 62% des victimes déclarent porter encore aujourd’hui des séquelles psychologiques, proportion qui grimpe à 85% pour celles qui ont subi un harcèlement de plus de 2 ans. Ces chiffres illustrent que le harcèlement ne détruit pas seulement le présent mais hypothèque l’avenir : perte de confiance en soi, repli social, anxiété chronique, troubles du sommeil, décrochage scolaire. Certaines victimes mettent des années, voire des décennies, à se reconstruire – quand elles y parviennent. Mais le harcèlement dévaste aussi les familles. Les 84 entretiens avec des parents révèlent un profond désarroi : sentiment d’abandon face à une institution qui minimise ou nie, décisions radicales (déménagement, déscolarisation). Les témoignages décrivent des situations où l’enfant ne dort plus, ne mange plus, parle de mourir – et où l’école répond que « ce sont des jeux d’enfants ». Le harcèlement ne détruit pas qu’un élève : il fracture des familles entières et brise durablement la confiance dans l’institution scolaire.
La réponse institutionnelle : entre failles manifestes et réussites locales
La réponse des établissements scolaires face au harcèlement révèle une réalité contrastée. Un chiffre en particulier interpelle : 60% des harceleurs déclarent n’avoir jamais été sanctionnés. Cette donnée objective une réalité préoccupante : dans 6 cas sur 10, la violence reste sans réponse institutionnelle. Les 84 entretiens avec les parents permettent de documenter les mécanismes de cette inaction : minimisation de la gravité (« ce sont des jeux »), responsabilisation de la victime plutôt que sanction du groupe (« il doit apprendre à se défendre »), refus du terme « harcèlement » au profit de « tensions entre élèves », signalements perdus, protocoles jamais activés. Ces dysfonctionnements, lorsqu’ils se cumulent, aggravent le traumatisme et brisent la confiance des familles. Mais l’étude révèle aussi l’existence d’établissements qui gèrent efficacement les situations : réaction rapide dès les premiers signaux, sanctions claires, activation de protocoles structurés, formation des équipes, travail sur le climat scolaire. Dans ces cas, certaines situations se résolvent en quelques jours, avant que les séquelles ne s’installent. Ces réussites confirment un constat central : l’intervention précoce et systématique fait toute la différence. Lorsque l’institution prend ses responsabilités immédiatement, elle limite considérablement les dégâts et peut stopper net la dynamique de groupe.