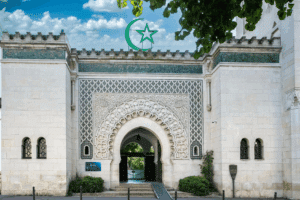Un attachement fort à l’industrie, entre fierté nationale et conscience du déclin
La réindustrialisation reste, depuis 2011, une priorité pour les années à venir aux yeux d’une écrasante majorité (87% cette année, contre 88% en 2011, avec un pic à 94% en septembre 2012).
Entre 2012 et 2025, la confiance dans l’avenir de l’industrie française se confirme (76% contre 73% en mai 2012). D’ailleurs, depuis 2024, l’image de puissance industrielle de la France retrouve quelques couleurs : 56% des Français estiment que le pays reste une grande puissance dans le secteur, un niveau supérieur à la période 2010 – 2014, où cette opinion n’avait jamais dépassé 49%. Pourtant, cet optimisme ne gomme pas le sentiment de déclin, ancré dans la durée : 85% estiment aujourd’hui que l’industrie a beaucoup décliné ces dernières années (ils étaient entre 82% et 94% dans les années 2010). Chez les hommes, le sentiment de déclin est d’ailleurs particulièrement marqué (92% contre 78% des femmes).
Une réindustrialisation jugée possible, malgré des freins : un cadre jugé lourd et coûteux, une acceptabilité locale à parfaire
Pour les Français, le pays a encore les moyens de sa réussite. 65% des Français estiment que cette réindustrialisation est encore possible, mais sous réserve de profondes réformes pour 42% des Français. 21% des répondants se montrent plus pessimistes, au regard des conditions actuelles. En revanche, seuls 3% expriment un profond défaitisme, estimant qu’il n’est plus du tout possible de réindustrialiser la France. Les hommes se montrent beaucoup plus optimistes : 70% estiment que la France a les moyens de réussir sa réindustrialisation dont 28% tout à fait, sans émettre de conditions. Les femmes sont sensiblement plus prudentes (60%, dont 18% « tout à fait »).
Trois verrous majeurs à la réindustrialisation sont identifiés : la complexité des normes et des démarches administratives (47%), le manque de stabilité des politiques publiques (44%) et le coût du travail (38%). Le manque de main-d’œuvre qualifiée (15%) et les oppositions locales aux projets (14%) apparaissent, en comparaison, plus secondaires.